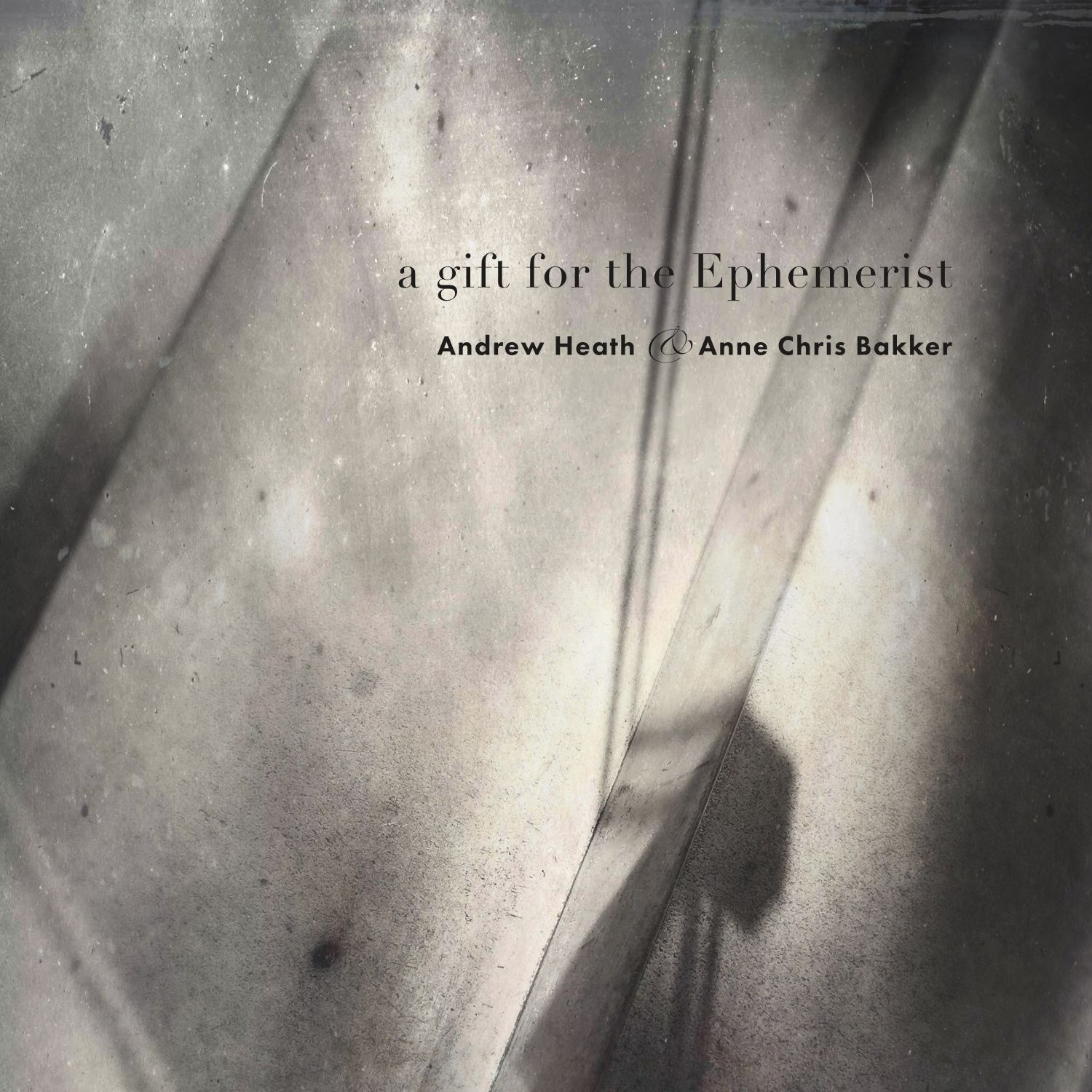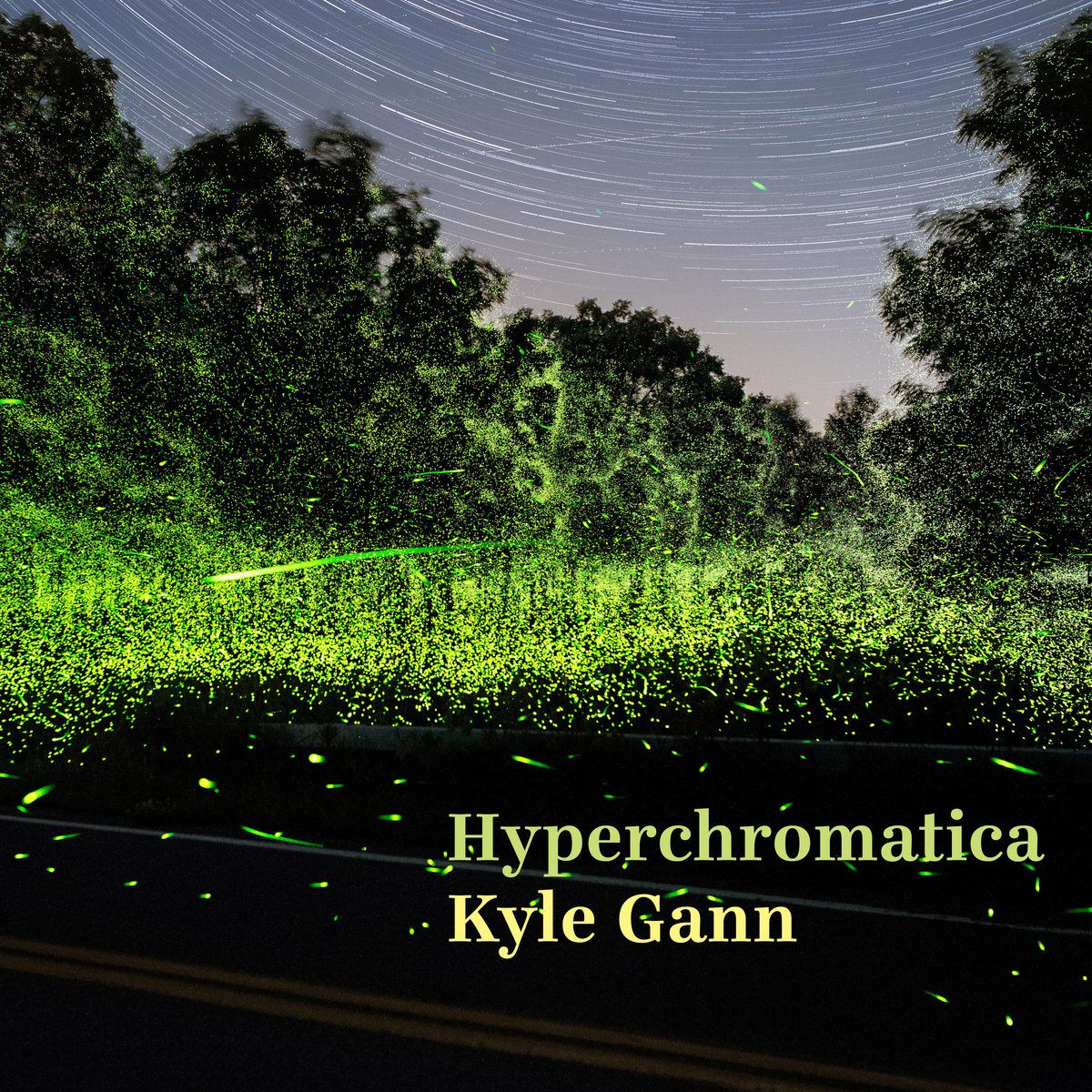Je serai toujours à la traîne avec Rutger Zuydervelt, alias Machinefabriek qui, de Rotterdam, nous inonde de ses productions. Clin d'œil, pour ce titre unique de mai 2019, intitulé eau, en français. C'est une autoproduction orpheline en quelque sorte, comme il en sort de plus en plus, la notion même de disque sur le point de disparaître. Toutefois, ce n'est pas un titre pour zombie pressé, avec ses trente minutes et dix secondes. Il y retrouve une autre néerlandaise, Mariska Baars, de Leyde, avec laquelle il a déjà collaboré à plusieurs reprises. Rutger dit ceci de eau : « eau n'est pas vraiment une chanson, ou une composition. Bon, techniquement, c'en est une, mais cela fonctionne plutôt comme une atmosphère qui remplit l'espace. Laissez faire la musique, rejouez-la, laissez les sons flotter dans la pièce - laissez-les coexister avec n'importe quel autre son. Ouvrez une fenêtre si vous voulez. Ou faites l'expérience d'un voyage avec les écouteurs, laissez ces doux sons, ces douces voix, ces bourdonnements et ces crépitements chatouiller l'intérieur de votre cervelle. »
Le titre commence avec la voix comme écorchée de Mariska, démultipliée, tronçonnée en boucles brèves, puis soulignée par des notes tenues de synthétiseur, des bruits d'allumettes grattées peut-être. Tout commencerait dans le feu, par la voix brûlée dont s'échappe l'autre voix, la "vraie", aux inflexions caressantes, la voix des profondeurs, du rêve, tendrement épaulée par une guitare. Les volutes électroniques enveloppent vite un véritable chœur de voix, certaines en avant, proches, d'autres lointaines, séraphiques. Des phrases mélodiques reviennent inlassablement dans ce flux changeant, miroitant. C'est un travail d'orfèvre sonore, comme toujours quand Machinefabriek est à son meilleur niveau, comme ici, d'une beauté à couper le souffle. Tout tourne lentement, lent ballet d'apparitions sonores, les voix de Mariska doublées par des voix masculines à l'arrière-plan. La notion même de temps est bousculée, dans la mesure où ce flux charrie en même temps des fragments antérieurs et de nouvelles vagues. Au bout de dix minutes, tout le chœur semble couler pour ne laisser que la guitare et les claviers, avec très brièvement un dulcimer (?) aussi, les graves l'emportent, c'est une dérive, une fusion palpitante, agitée de clapotements infimes, serions-nous dans les grands fonds ? Des ponctuations lumineuses animent cette coulée, de plus en plus plombée par des drones. Tout résonne incroyablement, et vers dix-sept minutes on commence à réentendre d'abord les voix masculines, puis celles de Mariska derrière cette ligne massive de coraux. Début d'une lente remontée, d'une mêlée sensuelle étrange, trouble, entre voix et instruments, sons et bruits énigmatiques, avec quelques minutes marquées par l'égrènement de touches percussives, de cloches sous-marines. Croît l'impression d'un cortège somptueux nappé de voiles harmoniques aux multiples couches, avant qu'un coup d'arrêt (le dulcimer à nouveau ?) ne décante l'ensemble, les voix comme libérées d'une gangue, puis qui repartent, noyées au milieu de zébrures, d'une inflammation des textures sonores, d'une dépression sourde, de plus en plus étale, létale... sur laquelle se pose le souvenir de la voix engloutie et de ses sœurs lointaines. En somme ? Rien de moins qu'un magnifique opéra sans parole, la réécriture musicale inspirée de La petite sirène ou d'Ondine !
Le disque est postproduit par Stephan Mathieu, compositeur et artiste sonore dans le domaine de l'électroacoustique. Du très beau travail !
---------------
Paru en mai 2019 / Autoproduction / 1 plage / 30'10
Pour aller plus loin :
- le disque en écoute et en vente sur bandcamp :

/image%2F0572177%2F20170208%2Fob_fdd513_duane-pitre-bridges.jpeg)
/image%2F0572177%2F20211222%2Fob_d5e945_jacquemin2.jpg)





/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_5d1af1_bruit-noir-ii-iii.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_30bdff_melaine-dalibert-musique-pour-le-lever.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_0d6959_kyle-gann-hyperchromatica.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_06e910_amuleto-miszte-riumok.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_df998f_jonathan-fitoussi-clemens-hourrie-re.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_a5bd81_machinefabriek-anne-bakker-short-scene.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_9f52b1_christina-vantzou-n-4.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_1a785b_ambroise-a-la-tonalite-pre-fe-ra.jpg)
/image%2F0572177%2F20191231%2Fob_3667e9_michel-banabila-imprints.jpg)