Publié le 11 Août 2017
Dans le livre Cosmos de Michel Onfray, un chapitre s'intitule "Faire pleurer les pierres". En voici le début :
« Caillois faisait parler les pierres : la vitrification des forces qui furent inspire assez peu en dehors des géologues. Pourtant, il y a des millions d'années, des liquides en fusion, refroidis, ont donné l'obsidienne et le diamant, le quartz et le jaspe, la calcédoine et l'agate, l'onyx et la variscite, le lapis-lazuli et la paesina, l'améthyste et la fluorine. une fois ouvertes en deux et polies, on découvre que les pierres contiennent des simulacres, écrit le poète. Dans ce que cette ouverture au monde montre, on peut voir des monstres et des visages, des paysages et des personnages, des silhouettes et des arbres, des oiseaux et des dragons, des écrevisses et des cours d'eau, des chiens et des t^tes de mort tout autant que des rêves et des présages.
Ce qui caractérise les pierres ? Leur silence, malgré leur longue mémoire, leur immobilité figée dans une forme, la radicalité de l'invariabilité de leur structure, leur vie loin du vivant, leur force tranquille, la cristallisation du temps. Mais aussi le relatif mépris dans lequel les tiennent les poètes et les artistes, les écrivains et les musiciens, les gens de l'art que ce temps pétrifié n'intéresse que de façon très exceptionnelle.
Qu'Orphée ait pu faire pleurer les pierres, voilà qui renseigne sur le pouvoir de la musique (qui est temps culturel versifié) sur les pierres (qui sont temps naturels cristallisés). »
L'extrait m'intéresse d'abord parce qu'il renvoie à Roger Caillois, écrivain, poète, critique, homme libre, introducteur de la littérature fantastique latino-américaine en France, vraiment un des grands esprits du XXe siècle, trop peu lu aujourd'hui. Michel Onfray fait allusion sans doute au livre La Lecture des pierres, qui, outre les photographies de la très belle collection personnelle de Caillois, contient les textes-poèmes s'y rapportant. Ne l'ayant pas encore lu, je l'inscris sur mes tablettes.
Ensuite, que la musique puisse émouvoir les pierres, certains musiciens le savent, s'y essaient. Stephan Micus (né en 1953), musicien allemand passionné par les instruments traditionnels de tous les pays, avait sorti en 1989, sur le label ECM, un album intitulé The Music of Stones, inspiré par les pierres résonnantes du sculpteur Elmar Daucher. Quatre musiciens, dont lui-même et son épouse japonaise, font chanter les pierres. Stephan Micus y ajoute shakuhachi (longue flûte japonaise en bambou), autres flûtes et voix.
J'en profite par conséquent pour rendre hommage à ce musicien discret, compositeur d'une œuvre prolifique entièrement publiée chez ECM.
(Liens mis à jour + ajout d'illustrations visuelles et sonores le 23 septembre 2021)

/image%2F0572177%2F20170208%2Fob_fdd513_duane-pitre-bridges.jpeg)
/image%2F0572177%2F20211222%2Fob_d5e945_jacquemin2.jpg)






/image%2F0572177%2F20210804%2Fob_2656a8_henneberg.jpg)
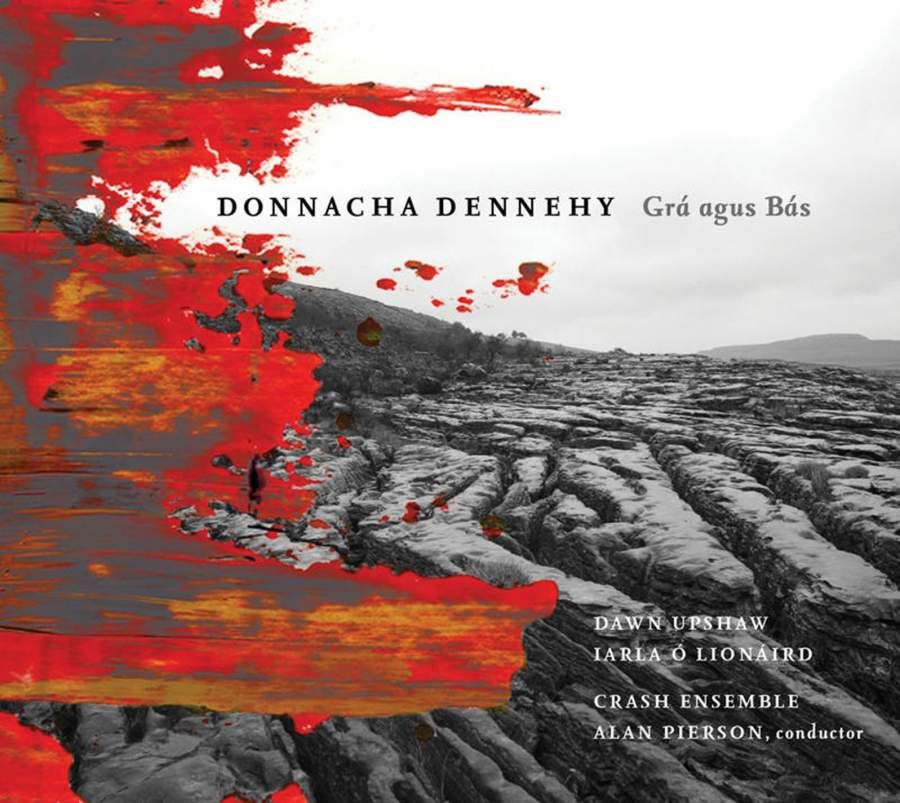
/image%2F0572177%2F20210421%2Fob_163696_tarkovski-andrei-le-miroir-1h32-32.jpg)
/image%2F0572177%2F20210401%2Fob_a7f077_val1.jpg)