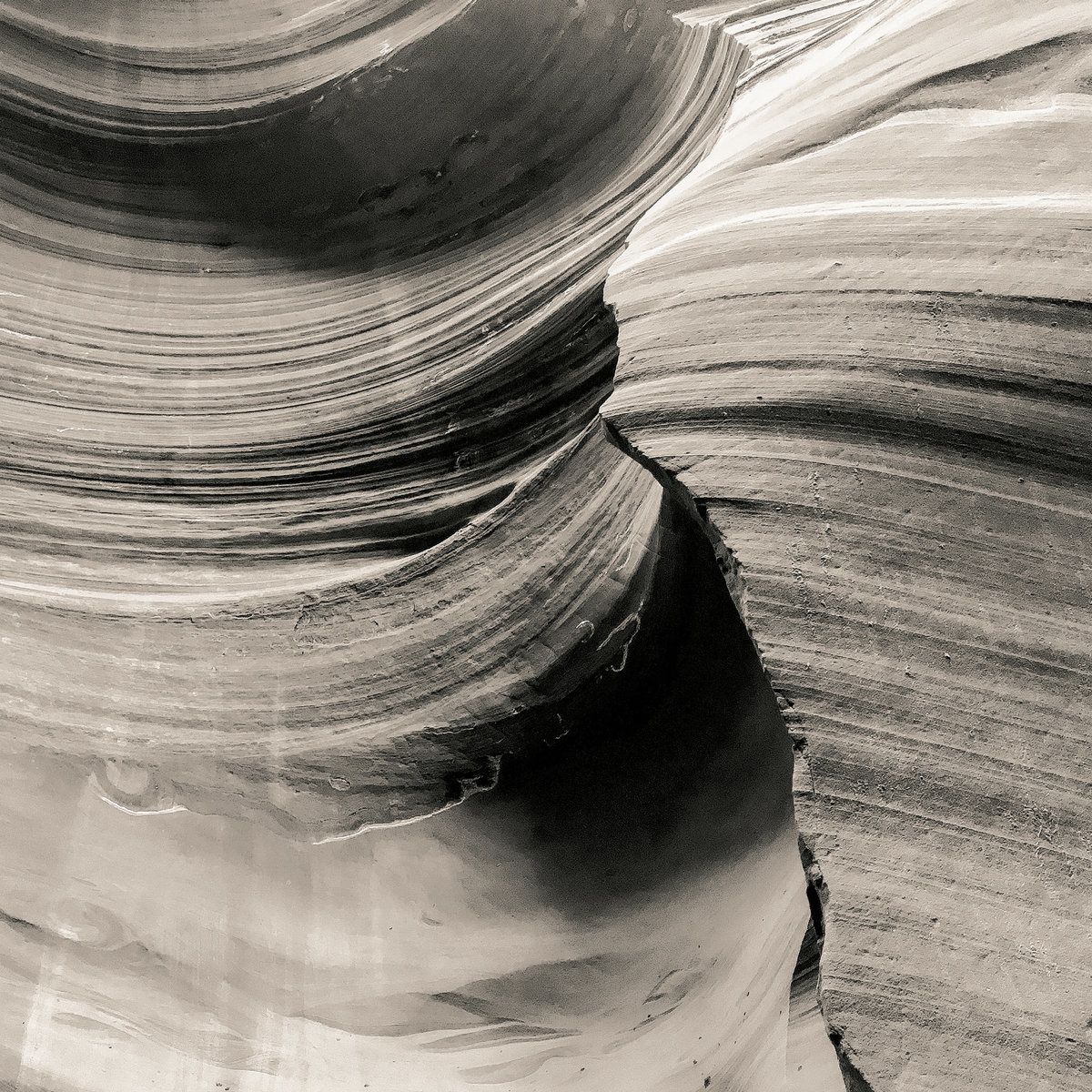Publié le 24 Octobre 2019
La musique de chambre, au large...
Guitariste et compositeur, Bruno Letort est éclectique depuis ses débuts, publiant dans les années quatre-vingt des albums à la frontière du jazz et du rock, multipliant les collaborations avec des musiciens issus du jazz et des musiques improvisées, composant pour le théâtre, le cinéma, la danse. Producteur sur France Musique, il fonde le label Signature, sur lequel on retrouve quelques artistes présents dans ces colonnes, notamment le guitariste Fred Frith - on verra plus loin pourquoi je mentionne ce musicien inclassable qui a publié aussi chez Tzadik, grand label des musiques expérimentales. Avec Cartographie des sens, Bruno Letort rassemble une collection de pièces qui invitent l'auditeur à abandonner très vite ses préjugés ou clichés sur la musique de chambre. La pochette donne à lire un texte de présentation impeccable d'Alexandre Castant, auquel je renvoie pour les indications plus techniques et les références précises. L'un des axes de cette collection est la thématique de la séparation, de l'exil, de la migration, sensible dans le choix des textes et certains titres
En ouverture, le titre rimbaldien "Semelles de vent" annonce une aventure, ici la rencontre entre un quatuor à cordes et la voix de la chanteuse éthiopienne Éténèsh Wassié, entre la culture occidentale savante et l'éthio-jazz, forme de jazz populaire dans son pays. On pense évidemment à certains disques du Kronos Quartet, qui affectionne ce type de friction stimulante. La chaude mélopée de la voix est soutenue par un quatuor à la musique entraînante, qui se fait vite lancinante, approfondie par des échappées électroniques, des touches de clarinette (?), des échos soutenus de voix dans les lointains, une basse grondante parfois, ce qui donne à toute la fin un parfum mystérieux. Après une telle alliance métissée, "Absence" surprend par son côté apparemment musique ancienne. L'Ensemble vocal Tarentule développe une polyphonie qui déstructure un texte de l'écrivain contemporain Orlando de Rudder, jouant des boucles, des accélérés et des ralentis, des timbres aussi en un éblouissant bouquet de voix, d'éclats, de suavités imprévues : la musique de la Renaissance fondue dans une approche plus contemporaine brouille en fait les pistes pour mieux réjouir l'oreille.
Retour au quatuor à cordes dans sa forme classique avec le cycle "E.X.I.L" en quatre mouvements, interprété par le Grey Quartet...oui, mais enrichi de textures électroniques, de bruits. L'atmosphère du premier mouvement, élégiaque, est chargée d'inquiétudes exprimées par des drones, des cliquetis. La tension s'accroit pour se vaporiser autour de virgules percussives lumineuses, comme d'une boîte à musique enchanteresse tandis qu'une aura électronique enveloppe les cordes. Splendide début ! "EX.I.L 2" développe une plainte parfois discordante, puissante, agitée de soubresauts impressionnants, avec des passages langoureux : c'est le cœur dramatique du cycle. Retour à une inquiétude diffuse dans le troisième mouvement, marqué par des inflexions déchirantes, des cassures, des trouvailles sonores parfois magnifiques, en particulier ce friselis cristallin tel un leit-motiv qui embaumerait la douleur, la souffrance. Quelle fresque variée, fouillée dans les moindres détails, belle de la beauté d'un désespoir qui s'accroche quand même à l'espoir ! La mer est là qui gronde aux portes de la nuit... Aussi le dernier mouvement peut-il se comprendre comme l'explicitation de ce que la musique exprimait : Jean-Marie Gustave Le Clézio, d'une voix claire, péremptoire, réfléchit à la question de la responsabilité qui nous incombe, à nous pays riches, face à la misère des déshérités qui migrent. Accompagné par les cordes, il nous assène une leçon lourdement rhétorique. Mieux vaut lire Désert, qui dit bien mieux les choses, de manière littéraire et non idéologique ! C'est la partie à mon sens la plus faible du cycle, parce que démonstrative, et d'une froideur contre-productive. Les trois parties précédentes se suffisaient à elles-mêmes, expressives, poignantes, et si belles sans paroles de vérité. La vérité de la musique n'est pas celle du logos, c'est celle des sens justement, du ressenti dont tout ce qui précède nous dressait la si émouvante cartographie.
Que "Draisine' soit liée à un projet inabouti autour du chef d'œuvre d'Andréi Tarkovski, Stalker, m'interpelle évidemment. Servie par un sextet (basse, percussions, piano, violon, alto et violoncelle), cette courte pièce oscille entre musique de chambre et jazz, entre mélancolie légère, langoureuse, et tentation sublime avec le piano funambule sur des crêtes lumineuses, épaulé par la basse et une clarinette basse interrogatrice. "Rebath", anagramme de "breath", met en espace sonore une flûte confrontée à un environnement électronique qui semble la démultiplier, lui faire écho non sans ironie mordante, comme si elle se rebaignait dans ses propres sons devenus méconnaissables. Étonnante pièce, si vive, si fraîche, constamment en allée dans une fuite désordonnée, un peu sauvage, doucement panique...
... de quoi annoncer les trois "Fables électriques" qui suivent, pour guitare électrique et électronique. Presque un début de musique industrielle pour la première d'entre elles, percussion sourde et sons triturés avant le lâcher de guitare(s), démultipliées elles aussi, scansion monotone en crescendo, explosion saturée avant une nouvelle vague d'assaut. Nous sommes dans un univers métallique, impitoyable, brûlant de froideur, fracturé par des déchirures âpres, ce qui n'est pas sans évoquer l'univers du guitariste Fred Frith cité en début d'article, ou encore celui de Marco Capelli et son "Extrem Guitar project". Cette première fable ne serait-elle pas le bulldozer de la civilisation occidentale faisant place nette par sa sombre puissance ? La deuxième est d'abord plus torturée, introvertie, immergée dans un bain électronique : elle se change vite en hallucination et magie rituelle sur fond de voix spectrales, tout en résonances percussives radieuses, pas si éloignées que cela des bols chantants tibétains. On peut la voir comme un mouvement lent de sonate, un intermède avant la reprise de la première fable sur un mode plus frénétique, agressif, lourdement répétitif. L'atmosphère est grondante, saturée, pulsante telle une danse claudicante de géant déhanché parcourant les décombres de villes détruites. Une trilogie formidable, à écouter à plein volume !
L'aventure se termine avec "The Cello stands vertically, though...", ode au violoncelle en cordes libres, si l'on peut dire, bateau ivre rimbaldien, ce qui nous ramène au début de ce voyage, de cette traversée de quelques unes des nouvelles modalités de la musique de chambre d'aujourd'hui, où la guitare électrique, l'électronique côtoient, rencontrent les instruments plus classiques du genre. Bruno Letort s'inscrit ainsi dans le courant de décloisonnement représenté aux États-Unis par les compositeurs du protéiforme Bang On A Can, festival, ensemble et label fondés par David Lang, Michael Gordon et Julia Wolfe.
Oubliez vos préjugés : cette musique contemporaine-là est sacrément belle, vivante, surprenante, prenante !
Mes titres préférés : "Fables électriques" (les 3 !) / "E.X.I.L" 1 à 3 / "Semelles de vent" / "Draisine"... et j'aime assez trois des quatre restants, à l'exception de celui que j'ai indiqué !
----------------
Paru en septembre 2019 chez Musicube / 12 plages / 51 minutes environ
Pour aller plus loin :
- "E.X.I.L 1" (ci-dessus) et "Fables électriques" Mvt 3 (ci-dessous) en fausses vidéos :
(Liens mis à jour + ajout d'illustrations visuelles et sonores le 15 octobre 2021)

/image%2F0572177%2F20170208%2Fob_fdd513_duane-pitre-bridges.jpeg)
/image%2F0572177%2F20211222%2Fob_d5e945_jacquemin2.jpg)




/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_fafaed_radi1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_06e309_mel1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_34d51d_wall1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_17055d_lang1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_f18d88_licht1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_8713c7_eno1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_ac42a9_ryan1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_1b8e28_trips.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_6e0375_dan1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_d133cf_raats1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_ad5b8f_satie1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_cac6d0_return.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_26f402_sofia1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_1c1d3a_berg1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_0a078e_dark1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_02f6e4_grant1.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_7162d8_lodz.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_5ed82f_dize.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_487e60_becoming.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_261517_manink.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_917b2c_12.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_e8aebf_negative.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_a68e21_cordes.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_b51dc3_astrid.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_d09c93_moin.jpg)
/image%2F0572177%2F20191009%2Fob_50a70a_orson.jpg)