Publié le 5 Mai 2017
Je ne sais pas si j'ai un cœur de lion, mais les Richard m'attirent dans leur orbite. Après la découverte majeure de Richard Moult, c'est au tour de Richard Skelton de s'imposer à mes oreilles. Originaire du Lancashire, cet anglais vit actuellement sur la côte ouest de l'Irlande. Comme Richard Moult, c'est un musicien enraciné dans des paysages naturels sauvages d'une grande beauté, particulièrement les landes de la chaîne des Pennines. Il a commencé à composer de la musique après la mort de sa femme Louise en 2004. Ce travail de deuil, d'une certaine manière, a pris des dimensions considérables : sous plusieurs pseudonymes en plus de son propre nom pour d'innombrables albums, tant sous forme physique que sous forme de téléchargement. Je commence seulement à aborder ce continent sonore, découvert à la faveur d'une vidéo sur YouTube. On le rapproche régulièrement de Brian Eno, pour la dimension ambiante de son œuvre, et d'Arvo Pärt pour son atmosphère de religiosité ardente et désolée. De fait, par-delà les rapprochements, il vaut pour lui-même, ayant bâti un univers singulier, beau et puissant.
En ce non-lieu très sûr et très vertigineux
Conçu du printemps 2010 à l'hiver 2011, Verse of Birds (et Véarsa Éan en irlandais, titre du disque 2), qu'on peut traduire par Vers d'oiseaux, ou Versets d'oiseaux (plus heureux en français !), a été enregistré sur la côte ouest de l'Irlande. À l'origine, le disque est conçu comme l'accompagnement sonore des textes du recueil The Flowered rocks, publié chez Corbel stone Press comme le disque, recueil que je n'ai pas encore lu. Le premier titre, "Vessel", installe une brume sonore tissée de harpe (?), guitare et cordes entrelacées indissociables d'un arrière-plan de retraitements électroniques. C'est une écume épaisse surgie de la mer sur laquelle glisse le vaisseau, une écume immémoriale, frémissante. Il n'y a pas de rivage, seulement ce chevauchement âpre sur les collines des vagues. "Calm bearer" est un concert de plaintes écorchées, soulèvements de cordes dans un chœur en canon perpétuel à la lancinante beauté. On retrouve la harpe, ou plutôt le dulcimer, sur "Bond that Does not break". Chaque pièce est un poème sonore composé de variations agencées en boucles, ce qui n'est pas sans faire penser au minimalisme, mais ici l'ampleur des variations se fait symphonique. "Bond that Does not Break" le dit à sa manière : le lien ne casse pas, lie la chaîne harmonique qui, pour être traversée de surgissements incessants, ne dévie pas de son cours, de son rythme océanique. Des courants nous portent vers le promontoire, "Promontory", incantation dans les aigus aiguisés, les raclements, quelque chose d'énorme nous aspire, sauvage. Quelle musique grandiose, à la splendeur farouche ! Et la mer nous reprend, rude et fière, le dulcimer imperturbable campé sur la houle profonde et le chant des violons comme l'envol de milliers d'oiseaux, entendu peut-être depuis les chambres étroites du navire, "The Narrow Rooms" du titre. Arrivé là, je craque, littéralement happé par l'hymne à la mer qu'est "Of The Sea", où l'on croit entendre dans chaque vague la plainte des goélands. Plus de huit minutes trente, mais cela pourrait durer toute l'éternité. Horizon infini de pleine mer, infinis tournoiements qui ligotent le Temps, le densifient pour qu'il rende l'âme une bonne fois pour toute. Majestueux requiem d'un hors-temps à l'indestructible sérénité par-delà les aléas et les frimas. Le premier disque se termine avec "Grey-back", plus de quatorze minutes d'une respiration abyssale, spectrale, comme si tous les instruments étaient voilés. Cette pièce d'une mélancolie désolée me fait penser à "As Long as I can Hold my Breath", deuxième partie de l'album Avallon Sutra de Harold Budd, en plus implacablement sépulcral. Extraordinaire, en tout cas !
(En écoute le titre 6 du disque 1)
Le deuxième disque s'ouvre avec "Ascend", dialogue lancinant entre un clavier égrenant ses notes avec un calme royal et un violon à l'arrière-plan tout en griffures vives et désordonnées. Peu à peu, l'intervalle entre les deux interlocuteurs se comble d'un vêtement instrumental de plus en plus dense. C'est un long envol majestueux, fastueux, souligné par de mystérieuses cymbales lorsque les oiseaux s'éloignent et disparaissent. "Little knives" suit sans transition silencieuse. Sommes-nous dans un nuage de volatiles en partance ? La musique frémit comme de multiples ailes, soudain transfigurée par ce qui ressemble à l'irruption de vagues de moog. Myriade de stridences, de cris perçants enveloppés d'une aura symphonique proprement fabuleuse. Cette musique transporte, c'est la vie reconquise, fulgurante, qui nous laisse sur une plage, un peu égarés, ravis, dans une atmosphère nébuleuse à la Tangerine Dream, celle des premiers albums. "A Kill" a des allures de raga, lente méditation à la guitare sur fond de bourdons instrumentaux qui évoquent les cornemuses. De quelle mise à mort ou meurtre s'agit-il ? Le morceau garde son mystère, se clôt sur des des gerbes de cymbales énigmatiques, et voici "Véarsa Éan", piano lumineux et cordes inextricables, l'aube d'un ailleurs absolu, de l'autre côté du monde, des manifestations. La musique se fait efflorescence prodigieuse, éclosions multiples, foisonnements de beautés éphémères, avant de se résorber dans le brouillard des cymbales rituelles.
On croyait avoir atteint les sommets musicaux, mais "Domain", avec plus de dix-huit minutes, recule encore les limites de la beauté. Houles courbes de cordes, soulèvements rauques de voix, tout un moutonnement orchestral, un cercle de mugissements et de stridences éparses, comme un chaudron immense dans lequel se préparerait la suprême potion, au creux des creux, la pluie lustrale venue d'en bas laver tous nos tourments s'éploie, scandée par les battements d'une mer farouche, se diffuse dans les glissendi et les tournoiements râpeux de violoncelles comme autant de phoques pleureurs. Revient alors la grande harpe éolienne dans le jaillissement des vents brefs et des écumes radieuses, apaisantes.
Une splendeur absolue, terrassante !
[ Mon titre est emprunté à Saint-John Perse, Oiseaux, XI.]
------------------------
Paru en 2012 chez Corbel Stone Press / 2 cds, 7 + 5 titres / 1 h 47'
Pour aller plus loin :
- le site personnel du compositeur.
- "Little Knives" en écoute :
(Liens mis à jour + ajout d'illustrations visuelles et sonores le 14 août 2021)

/image%2F0572177%2F20170208%2Fob_fdd513_duane-pitre-bridges.jpeg)
/image%2F0572177%2F20211222%2Fob_d5e945_jacquemin2.jpg)







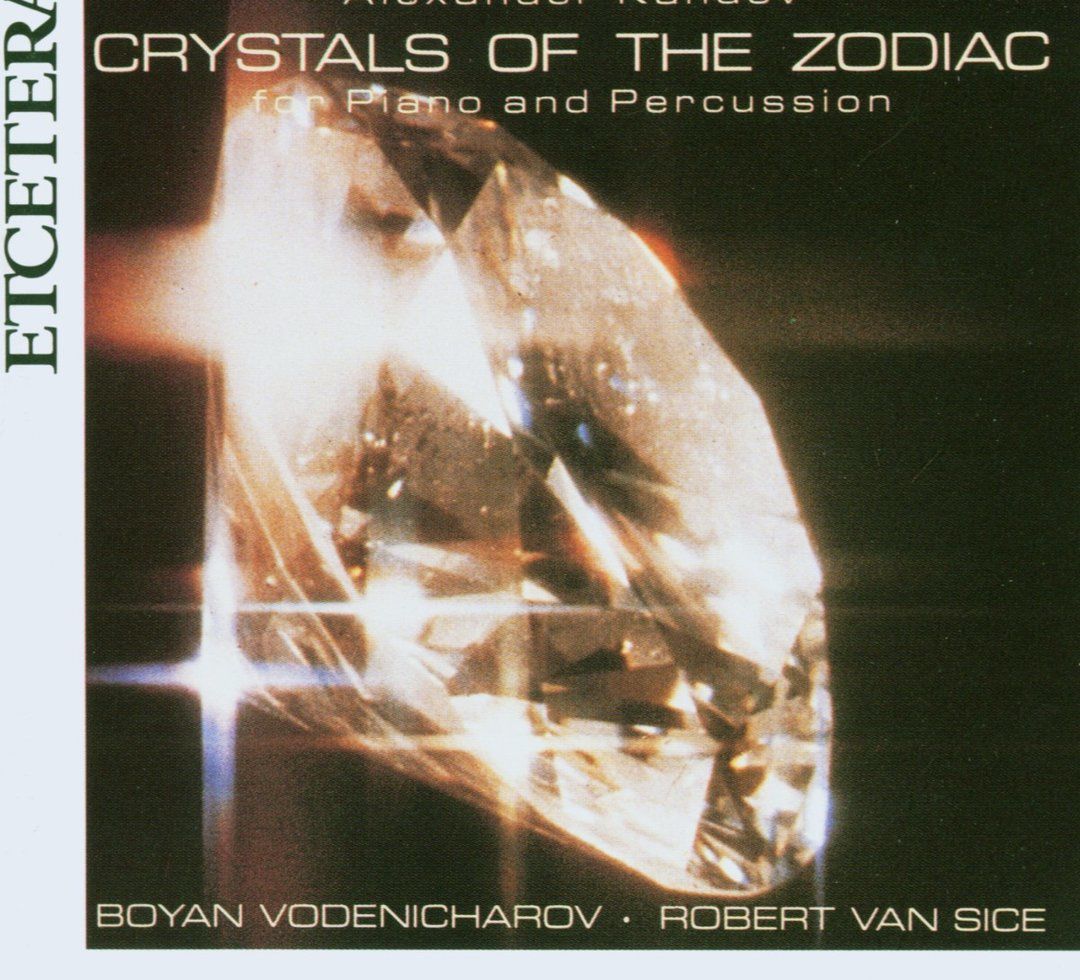
/image%2F0572177%2F20210813%2Fob_3a9be9_douwe-eisenga-the-piano-files-ii.jpg)

